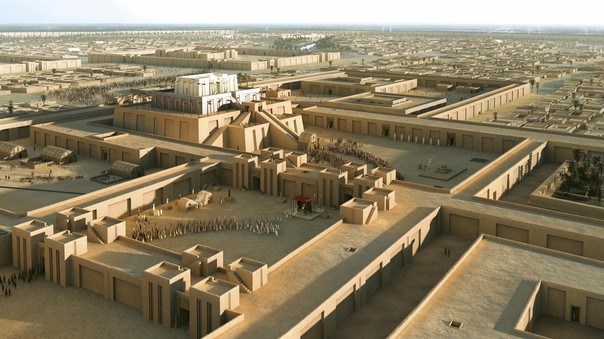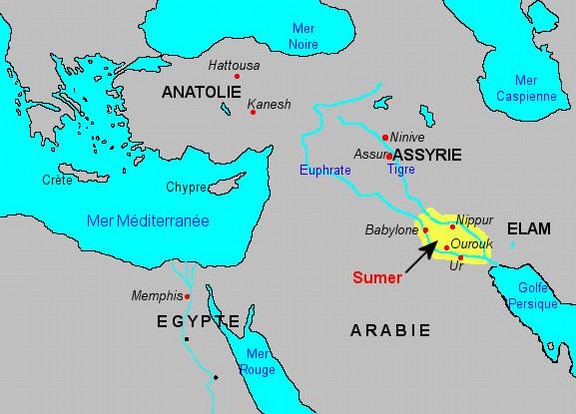Comment Sapiens, apparu il y a environ 300000 ans, en est-il venu à représenter la réalité ? La découverte, à Bornéo, du dessin d’un bœuf datant de 40 000 ans relance le débat. Car cette première trace d’art figuratif est quasi synchrone de celles de la grotte Chauvet en France (36000 ans), mais à des milliers de kilomètres de là ! Comment ce genre de simultanéité est-il possible? Existe-t-il un élément déclencheur dans le développement mental de l’espèce humaine, qui aurait offert à cette époque aux artistes d’aller au-delà des représentations abstraites des premiers âges et de leur suggérer d’orner les grottes de représentations animales ? Ou bien les premières peintures auraient-elles suffisamment marqués les hommes de l’époque pour que la vénération devienne contagion, d’un bout à l’autre de la planète ? Difficile à dire.
Mais cette première coïncidence n’est pas unique, elle est suivie d’une seconde, il y a environ 18000 ans : c’est l’époque à laquelle l’humain commence à apparaître aux côtés des animaux – voir à les remplacer – sur les parois des grottes ornées. C’est le cas à Bornéo, en Indonésie, entre 20 000 et 13 000 ans, dans le désert australien, il y a entre 18000 et 12000 ans, ou encore en France, dans l’abri sous roche de Roc-aux-Sorciers, à partir de 16 000 ans.
Des humains auraient-ils traversé les continents en un rien de temps pour répandre l’art figuratif ? Et si oui, pourquoi ? Maxime Aubert, de l’université Griffith, en Australie, en doute. Pour lui, cette quasi-synchronie « pousse plutôt à penser qu’il n’y a pas eu un seul et unique centre d’émergence de l’art figuratif, mais au moins deux, en Asie et en Europe. Étrangement, en ces points du globe, l’art semble s’être développé et avoir évolué en même temps et de la même façon. »
En des points tout à fait éloignés du monde, donc, au sein de populations différentes qui ne se sont a priori ni rencontrées ni concertées, apparaîtrait au même moment un saut cognitif parfaitement identique dans la forme ! Comment un tel prodige peut-il s’expliquer ? S’agit-il d’une incroyable coïncidence ?
Derrière les figures du bœuf de Bornéo et des lions de Chauvet, c’est bien la question de l’origine de l’art qui se cache, et donc celle de la pensée symbolique humaine. « Bien entendu, l’art existait avant l’essor du courant figuratif », commente Francesco d’Errico, directeur de recherche au CNRS : « Des œuvres plus anciennes, bien que non-figuratives, ont été retrouvées, et elles avaient un sens pour leurs auteurs. Certaines ont même été attribuées à d’autres espèces que la nôtre, comme Neandertal. La pensée symbolique humaine n’est donc pas uniquement nôtre, elle est peut-être même plus vieille que notre espèce ! »
Le chercheur fait ici référence à des peintures abstraites, comme ces croisillons vieux de 73 000 ans découverts en Afrique du Sud, ou encore des motifs datés de 65 000 ans retrouvés sur des parois en Espagne, lorsque seul Neandertal peuplait l’Europe.
Sauf que, entre ces tracés et celui d’un animal entier, le saut artistique est majeur. Et par ailleurs, toutes les peintures figuratives retrouvées sont attribuées à Homo sapiens – même si des doutes subsistent pour certaines, comme celles de la grotte des Merveilles à Rocamadour.
D’où une nouvelle question : pourquoi avons-nous été les seuls, parmi les homos, capables de dessiner les choses telles que nous les voyons ? Plusieurs hypothèses rivalisent ici. Sapiens, par exemple, aurait pu inventer ce nouvel art pour affirmer son identité, en réaction à sa rencontre avec Neandertal et Denisova (une autre espèce humaine disparue). Ou peut-être le temps a-t-il simplement manqué à ces derniers, disparus il y a environ 30 000 ans. Autre hypothèse : ils auraient, eux aussi, reproduit le réel là où ils se trouvaient, mais leurs œuvres ne nous sont pas parvenues. Enfin, peut-être le cerveau de Sapiens était-il prédisposé à ce nouveau courant d’expression et pas le leur, tant il est vrai que l’art figuratif est complexe et nécessite une forte maturité cognitive…
Que s’est-il passé, alors ? Pourquoi une telle manifestation de la pensée complexe est-elle apparue ici et là, tout d’un coup ? Et surtout, plus de 200000 ans après la naissance de notre espèce ! Pourquoi tout ce temps ? Une évolution cognitive singulière était-elle indispensable ? Sans doute est-ce la meilleure explication à nous mettre sous la dent. Mais alors demeure la question : pourquoi cette maturation si spécifique s’est-elle produite partout « au même » moment ?
Aucune explication satisfaisante pour l’heure…